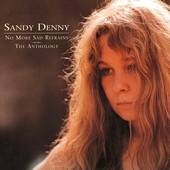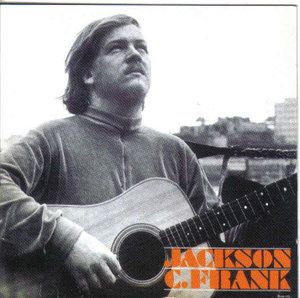Jackson C. Frank : le blues gagne la partie
La vie est une enfant de chienne ! Le 2 mars 1943, elle s’est penchée sur le berceau de Jackson C. Frank, lui a fait don d’un talent inouï pour la musique, et le lui a fait ensuite payer en lui allouant un destin si misérable qu’il a dû lui en vouloir à mort de l’avoir mis au monde ! Il avait onze ans quand cette salope lui a asséné son premier coup bas. Jackson vivait alors à Cheektowaga, dans l’état de New York. Ce qu’il préférait de l’école, c’était les cours de musique qui se donnaient dans une petite annexe toute de bois bâtie. Ce jour-là, elle a flambé, emportant dans sa mort 18 gamins. Jackson a survécu à ce massacre, mais les sept mois de calvaire qu’il passera à l’hôpital et les cicatrices tant physiques que psychologiques qu’il en gardera lui auront peut-être fait regretter parfois de ne pas avoir ajouté ses cendres à celles de ses petits camarades en ce jour maudit.
Sa bataille contre le désespoir, il l’aura gagnée grâce à cette guitare que l’un de ses professeurs lui a apportée pendant sa convalescence. Jackson avait déjà une voix d’une beauté et d’une pureté rares. Il a vite appris à l’habiller d’accords. Et il a perfectionné plus tard son jeu lorsqu’il a pu convaincre sa mère de lui acheter une guitare électrique, une Gretsch Streamliner avec laquelle il pouvait s’éclater en reproduisant les chansons d’Elvis, sa grande idole. Cet Elvis qui n’aura pas su que l’inspirer, mais lui aura aussi offert l’un des plus beaux moments de sa vie, de ceux dont il se sera probablement souvenu quand, tout au fond du gouffre, il aura cherché désespérément une image à laquelle se raccrocher. Elle s’est imprimée dans sa mémoire quand il avait 13 ans. Sa mère l’a emmené visiter Graceland. Si Jackson caressait l’espoir d’entrapercevoir le King, celui-ci l’aura comblé bien davantage en allant à sa rencontre et en l’invitant à entrer chez lui.
À 16 ans, Jackson se lance dans le rock’n’roll avec un pote. Puis se découvre une passion dévorante pour le vieux folk, particulièrement celui chanté pendant la guerre de sécession. Peu de temps après, il fait la connaissance de John Kay, futur chanteur de Steppenwolf, et hante avec lui les clubs où se produit la scène folk locale. Révélation ! Il sera chanteur. Ou journaliste, si chanter ne le mène à rien. Il s’inscrit alors au Gettysburg College, mais laisse finalement tomber l’idée de se lancer dans les études lorsqu’un coup du sort le dédommage pour ce qu’il a enduré enfant. Il a 21 ans quand il perçoit 100 000 $ d’une compagnie d’assurances, une véritable fortune dans les années 60. Ne sachant que trop bien à quel point la vie peut être éphémère, Jackson décide d’en claquer le maximum, là, et s’achète immédiatement une Jaguar.

Avec Kay, il roule jusqu’au Canada, traîne dans les clubs de Toronto et y fait la connaissance de quelques musiciens qui, comme eux à ce moment-là, s’illuminent au son du blues de John Lee Hooker et de Muddy Waters. Mais Jackson ne s’enflamme pas que pour la musique. Il aime aussi les bagnoles. Il lit dans un journal que les ventes d’automobiles les plus alléchantes se font à Londres. Il ira donc en Angleterre !
C’est au cours de son voyage en mer que Jackson C. Frank compose sa toute première chanson. Celle qui l’immortalisera, qui sera reprise encore des décennies plus tard par des jeunes musiciens qui le découvriront et seront foudroyés par le génie exceptionnel de ce gars méconnu. Dans Blues run the game, Jackson se raconte, étale le bleu de son mal à l’âme, le noie dans l’alcool et le dépeint de cette voix si incroyablement mélancolique et douce qui caresse ces mots :
When I ain’t drinking, baby,
You are on my mind,
When I ain’t sleeping, honey,
When I ain’t sleeping, Mama,
When I ain’t sleeping
Well you know you’ll find me crying.
Arrivé en Angleterre au milieu des années 60, Jackson C. Frank découvre rapidement un monde plus fascinant encore que celui des bagnoles qui l’avaient attiré sur le vieux continent. Le Swinging London fourmille alors de jeunes musiciens folks pour lesquels l’excentricité est socialement acceptable. Le contraste avec l’Amérique rigide que Frank laisse derrière lui est si saisissant qu’il en est euphorique. Il se lie vite d’amitié avec trois musiciens, Al Stewart, Art Garfunkel et Paul Simon. Ce dernier, totalement subjugué par ce qu’il entend lorsque Jackson lui joue quelques-unes de ses chansons, lui propose sur le champ de produire son premier album, ce que son compatriote accepte bien sûr sans une seconde d’hésitation. Al Stewart, qui a assisté à l’enregistrement de l’unique disque de Jackson C. Frank en compagnie de Simon et de Garfunkel, racontera plus tard que le musicien doutait tant de lui et était si nerveux qu’il demanda qu’on le cache derrière un écran pour que personne ne puisse le voir chanter. « C’était assurément la session d’enregistrement la plus étrange que j’aie connue, ajoutera-t-il. Quand Paul disait « ok, on y va », il y avait d’abord deux ou trois minutes de silence absolu. Puis émergeaient cette voix et cette guitare magnifiques… »
L’album séduira grandement la communauté folk du Swinging London. John Peel le fera même jouer souvent lors de sa légendaire émission de radio à la BBC. La réaction des auditeurs est si fulgurante que Peel se décide à inviter Jackson à venir chanter en direct. La télévision emboîtera le pas, ce dont il ne reste malheureusement que trop peu de témoignages visuels.
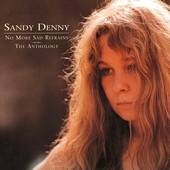
En ce Londres de 1965, Jackson fait également la connaissance d’une jeune infirmière de 19 ans, Sandy Denny. Elle est aussi peu sûre d’elle qu’il l’est lui-même. Ils se lient d’amitié, puis s’aiment rapidement. Quand Sandy s’essaye à interpréter les nouvelles chansons de Jackson, il sait que son avenir ne peut être ailleurs que dans la musique. Il la persuade de laisser tomber son emploi pour se plonger corps et âme dans le folk. C’est devant lui, en privé, qu’elle interprètera Who knows where the time goes et Fotheringay pour la première fois.
Jackson C. Frank fascine le public et les artistes d’alors autant par sa musique que par cette belle extravagance derrière laquelle il cache son manque d’assurance. Si Nick Drake, Bert Jansch et quelques autres reprennent ses chansons en les enregistrant chez eux ou en les jouant en concert, Al Stewart se souvient encore de ces tenues délirantes que Frank se plaisait à porter, de cette volonté manifeste qu’il avait de dépenser tout l’argent qu’il possédait, peut-être parce qu’il l’associait à l’incendie dont il trimballait toujours les séquelles psychologiques.
Frank savoure à peine son succès en terre anglaise que Londres devient déjà incontournable pour les musiciens folks qui commencent à se faire nombreux à débarquer de leur lointaine Amérique, diluant ainsi l’intérêt des mélomanes qui ne savent plus qui aller voir en concert de Bob Dylan, John Baez, Tim Hardin, Ramblin’ Jack Elliot ou tellement d’autres fraîchement arrivés. Jackson les accueille tous à bras ouverts, paye le repas aux plus fauchés, introduit ses compatriotes musiciens auprès du propriétaire du club le plus fréquenté par les amateurs de folk, Les Cousins. Jusqu’en 1967, il attire lui-même des foules nombreuses à ses concerts.
Mais 68 marque le début d’une désillusion qui le plongera dans une dépression dont il ne se relèvera jamais. Il compose difficilement de nouvelles chansons. Elles reçoivent un accueil tiède de la part d’un public qui se laisse porter aveuglement par un courant musical qui s’éloigne du folk introspectif pour s’ouvrir au hardrock. Jackson comprend alors que son rêve d’enregistrer un deuxième disque sera d’autant plus irréalisable qu’il apprend que les ventes de son premier album n’ont jamais décollé en Amérique. Sa maison de disques le lâche. Ruiné, déprimé, il se décide à retourner vivre aux États-Unis. Là, à Woodstock, il dirige un journal local pendant quelques années. Mais ce chien de destin s’acharne encore sur lui, cassant l’union qu’il formait avec un mannequin anglais, lui enlevant le fils qu’elle lui avait donné, atteint d’une fibrose kystique dont il meurt. Jackson, brisé, s’effondre. On l’hospitalise.
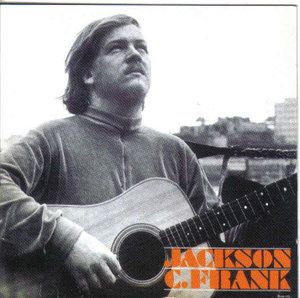
Sa descente aux enfers durera jusqu’au début des années 90. Inhumainement longtemps, il errera d’une institution psychiatrique à l’autre. Quand il n’y sera plus le bienvenu, il végètera dans la rue, triste clochard que plus rien ne distingue d’un autre. En cette sombre époque où l’on ne sait pas faire la différence entre la maladie mentale et la dépression sévère guérissable, on lui colle l’étiquette de schizophrène paranoïaque, on le bourre de médicaments, on noie son âme et sa créativité dans des substances chimiques. Puis vient un miracle tardif ! Il s’appelle Jim Abbott, il est un passionné de musique et flâne dans une boutique de disques d’occasion. Là, il tombe sur un vinyle d’Al Stewart, son célèbre Year of The Cat. Sur la pochette, il déchiffre ces quelques mots écrits à la main : « Regards to Jackson. The Blues Run The Game. Al ». Intrigué, il demande au vendeur s’il comprend ce que ça veut dire. Celui-ci lui répond que le Jackson d’Al est un clochard qui vient parfois lui revendre des vieux disques qu’il trouve çà et là. Abbott part à sa recherche, ne le trouve pas, et finit par oublier la dédicace pendant quelques années.
Jusqu’à ce que sa curiosité soit de nouveau piquée lorsqu’il s’achète l’album So Clear de John Renbourn dans lequel il trouve une reprise de Blues Run The Game. Et lorsqu’il lit le nom de Jackson C. Frank dans une biographie de Paul Simon. Il demande alors à un professeur avec lequel il partage sa passion pour le folk s’il a déjà entendu parler de ce mystérieux musicien. Étrange coup du sort… Ledit professeur connaissait personnellement Jackson C. Frank qui venait de lui envoyer une lettre dans laquelle il le priait de l’aider à quitter New York et trouver un endroit où loger à Woodstock. « Te sens-tu prêt à venir en aide à un chanteur folk possédé par la malchance ? », demande-t-il à Abbott.
Il l’est ! Il prend contact avec Jackson, l’aide tout d’abord à trouver un endroit où dormir, puis vient lui rendre visite pour la première fois. S’il n’avait jamais rien vu d’autre de lui qu’une photo datant des années 60, il a un choc monumental en découvrant ce gros monsieur dont il racontera plus tard qu’il lui faisait penser à Elephant Man. « Il n’avait rien. C’était tellement triste ! Il sortait juste pour manger et retournait à sa chambre. J’en avais les larmes aux yeux. Je le retrouvais quinquagénaire, et tout ce qu’il possédait était une vieille valise et une paire de lunettes cassée. »
Avec l’aide d’Abbott, qui parvint à lui faire obtenir des droits d’auteur sur son seul album, réédité dans les années 70, Jackson part s’installer à Woodstock. Mais auparavant, le destin s’acharnera une fois de plus sur lui. Alors qu’il est assis dehors, tranquille, un dingue lui tire une balle dans l’œil gauche, l’éborgnant sans raison.
Jackson C. Frank vivra quelques années moins malheureuses jusqu’à ce que son cœur le lâche, le 3 mars 1999, le lendemain de son 56e anniversaire. Lourdement handicapé par des années à dormir dehors, obèse, gros fumeur, avec une balle toujours logée dans l’œil, la bienveillance d’Abbott n’aura pu le sauver d’un départ précoce. Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes artistes qui, comme Counting Crows ou Eddi Reader, le découvrent et reprennent ses chansons. Veulent en connaître davantage sur ce musicien exceptionnel. Prennent connaissance de ce destin sordide qui fut le sien. Et se disent que la vie est vraiment une enfant de chienne !
Béatrice